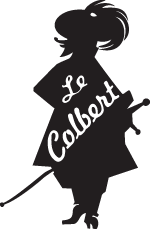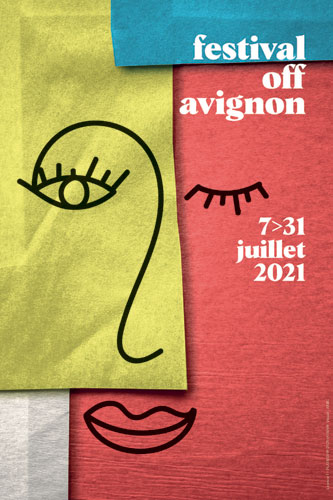Festival d'Avignon
Concept du festival d’Avignon
Chaque été, sous le soleil, la ville se transforme en une gigantesque scène de spectacle vivant. Dans la rue ou dans les théâtres, l’art se déploie partout!
Le centre ville d’Avignon (à l’intérieur des remparts) propose un grand nombre de théâtres dans lesquels sont programmés les spectacles du OFF (pour la plupart des créations).
Les spectacles du festival IN se déroulent dans des lieux de représentation en intra et extra-muros.
Les genres de spectacles proposés sont très variés: humour, jeune public, tous public,…